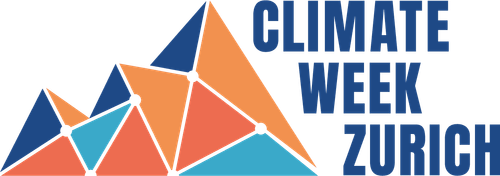Alors que le réchauffement climatique a dépassé pour la première fois en 2024 le seuil de 1,5 °C par rapport à la période préindustrielle, la liste des catastrophes ne cesse de s’allonger. En témoignent les inondations de fin octobre 2024 à Valence, qui ont coûté plus de 10 milliards d’euros à l’Etat espagnol. A la même époque, le gouvernement français dévoilait un Plan national d’adaptation au changement climatique, visant à adapter le pays à un scénario de réchauffement de +4 °C d’ici la fin du siècle. Ingénieur en résilience climatique et auteur du livre S’adapter au changement climatique, Ilian Moundib explique pourquoi il «refuse le narratif de l’adaptation à +4 °C». Explications.
Le Temps: D’où vient ce seuil de +4 °C auquel se réfère le plan français d’adaptation au changement climatique?
Ilian Moundib: Il tient au fait que l’engagement actuel des Etats nous conduit à un réchauffement de +3 °C au niveau mondial d’ici 2100, et de +4 °C en Europe, notre continent se réchauffant à un rythme plus rapide que le reste du monde. Une Europe à +4 °C se traduit d’abord par une irrégularité des températures, ce qui constitue une catastrophe pour les milieux agricoles. Et par le fait que nous aurons alors trois nouvelles saisons: la saison du trop chaud, en été surtout mais aussi au printemps, avec des canicules qui dureront plusieurs dizaines de jours, voire plusieurs mois. La saison du trop sec avec des conséquences dommageables sur l’agriculture et des répercussions sur les nappes phréatiques et sur le débit des cours d’eau. Et une saison du trop d’eau, en automne et en hiver, qui se traduira par des inondations dramatiques comme celles de Valence en Espagne. Le changement climatique accélère le cycle de l’eau. Un degré de température en plus, c’est 7% de potentiel d’évaporation en plus. D’où la multiplication des précipitations extrêmes.
Qu’en sera-t-il dans les autres régions du monde?
Certaines parties de la planète vont devenir inhabitables du fait de la conjonction de températures très importantes et d’une forte humidité. Des chercheurs de l’Université d’Hawaï ont publié une étude en 2017 qui montre que, dans le cas d’un scénario d’emballement climatique à +4 °C, les pays situés sous l’Equateur connaîtront plus de 300 journées par an de températures avec des taux d’humidité incompatibles avec la vie humaine. Il faut savoir que ces pays représenteront d’ici la fin du siècle plusieurs milliards de personnes, qui seront amenées à se déplacer. Cette situation va accélérer les migrations entre régions du sud mais aussi vers les pays occidentaux.
Pourquoi devrions-nous refuser d’envisager un tel réchauffement?
Les réductions des émissions de gaz à effet de serre sont des sujets d’ordre national. Alors que le niveau des risques auxquels les pays devront s’adapter dépend des émissions internationales, sur lesquelles les Etats n’ont pas la main. Viser une élévation des températures de +4 °C est néanmoins préoccupant, car il est très difficile de s’adapter à un tel réchauffement; cela revient à consentir à ce qu’une grande partie du Sud devienne invivable. En visant cette cible, les pouvoirs publics reconnaissent implicitement qu’ils ne vont pas réussir à baisser suffisamment leurs émissions. Or, si le réchauffement climatique augmente nettement au-dessus de +2 °C, il y a une probabilité très forte d’atteindre des points de bascule [par exemple une fonte accélérée des calottes glaciaires, ndlr]. On plonge alors dans l’incertitude complète et l’adaptation devient impossible. C’est pour cela que rester en deçà du seuil de 2 °C est essentiel. La réduction des émissions de gaz à effet de serre est en fait une condition nécessaire à l’adaptation.
Pourquoi mettez-vous l’accent sur la nécessité d’une réappropriation démocratique de ces questions?
En plus de devoir planifier d’urgence les grands chantiers de la résilience écologique, comme la désimperméabilisation de nos villes, nous allons avoir besoin de nous entraider face à des crises de plus en plus fréquentes. En impliquant les populations sur ces questions d’adaptation, on va mettre en mouvement ces réflexes. Cela passera à mon sens par la création d’institutions d’entraide sur le modèle de celui de la Sécurité sociale française. Une forme d’assurance sociale de l’alimentation, actuellement envisagée dans différents pays, irait par exemple dans ce sens.